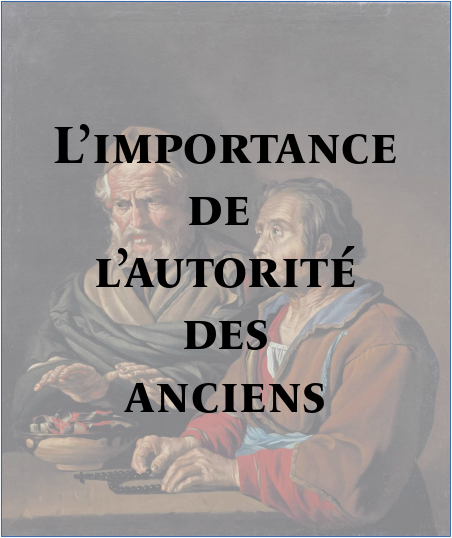Comment ont débuté les calomnies contre les chrétiens, celles-là même qui ont mené à leur injuste persécution ? Découvrons-le dans l’ouvrage de l’abbé Fleury, « les mœurs des Israélites et des chrétiens » (seconde partie, chapitres XV et XVI).
« C’était dans ces mêmes assemblées que l’on donnait tous les autres sacrements, autant qu’il était possible, et c’est pour cela que les infidèles en étaient exclus avec tant de soin. Car on observait inviolablement ce précepte du Sauveur, de ne point donner aux chiens les choses saintes, et de ne point jeter les perles aux pourceaux. De là vient que l’on nommait les sacrements mystères, c’est-à-dire choses cachées, et que l’on y gardait un secret inviolable. On les cachait non-seulement aux infidèles, mais aux catéchumènes. Non-seulement on ne les célébrait pas devant eux, mais on n’osait même leur raconter ce qui s’y passait, ni prononcer en leur présence les paroles solennelles, ni même parler de la nature du sacrement. On en écrivait encore moins, et si, dans un discours public, ou dans un écrit qui pût tomber en des mains profanes, on était obligé de parler de l’Eucharistie, ou de quelque autre mystère, on le faisait en termes obscurs et énigmatiques. Ainsi dans le nouveau Testament, rompre le pain, signifie consacrer et distribuer l’Eucharistie : ce que les infidèles ne pouvaient entendre. Cette discipline a duré plusieurs siècles après la liberté de l’Église. Il faut seulement excepter les apologies, dans lesquelles les Pères ont expliqué les mystères, pour justifier les chrétiens des calomnies qu’on leur imposait.
Au reste il n’était pas étrange aux païens de voir des secrets dans la religion, ils en faisaient autant pour leurs cérémonies profanes. Ceux qui étaient initiés aux mystères d’Isis, d’Osiris, de Cérès, d’Eleusine ou de Cybèle, ou des dieux de Samothrace, ou d’autres semblables, se croyaient obligés à les cacher sous de grandes malédictions, et passaient pour impies et pour scélérats s’ils venaient à les révéler. Apulée en fournit un exemple fort précis ; et c’est ce qui fait souvent dire à Hérodote, parlant de diverses cérémonies de la religion des Égyptiens et des autres : J’en sais bien la raison mais je n’ose pas la dire.
Ce secret des mystères ne laissait pas d’être un grand sujet de calomnie contre les chrétiens. Car on se cache plus souvent pour le mal que pour le bien ; et il n’était que trop notoire que, dans les autres religions, la plupart des mystères que l’on cachait avec tant de soin, n’étaient que des infamies ; comme dans les cérémonies de Cérès et de Cibèle ; et dans ces sacrifices de Bacchus qui furent défendus par ordre du sénat l’an de Rome 568. La prévention où l’on était contre les chrétiens, faisait aisément présumer que ce qu’ils tenaient si secret, était quelque chose de semblable. Ces soupçons étaient appuyés par les abominations que les gnostiques, les Carpocratiens, et d’autres hérétiques commettaient dans leurs assemblées ; et que l’on a peine à croire, même sur le récit qu’en font les Pères : car les hérétiques portaient tous le nom de chrétiens. Les catholiques mêmes avaient des esclaves païens, à qui la crainte des tourments faisait dire contre leurs maîtres tout ce que voulaient leurs ennemis.
Ainsi se répandit cette fable, que les chrétiens dans leurs assemblées nocturnes tuaient un enfant pour le manger, après l’avoir fait rôtir et couvert de farine, et avoir trempé leur pain dans son sang ; ce qui venait manifestement du mystère de l’Eucharistie mal entendu. On disait encore, qu’après leur repas commun, où ils mangeaient et buvaient avec excès, on jetait un morceau à un chien attaché au chandelier ; que ce chien en sautant renversait la seule lampe qui les éclairait, et qu’ensuite à la faveur des ténèbres, tout ce qu’ils étaient d’hommes et de femmes se mêlaient indifféremment comme des bêtes, selon que le hasard les assemblait. Les Juifs furent les principaux auteurs de ces calomnies ; et quelque absurdes qu’elles fussent, le peuple les croyait, et on était réduit à s’en justifier sérieusement. L’exemple des bacchanales, où deux cents ans auparavant on avait découvert des crimes si horribles, persuadait en général, qu’il n’y avait point d’abomination qui ne pût s’introduire sous prétexte de religion.
On accusait encore les chrétiens d’être ennemis de tout le genre humain, et de la puissance romaine en particulier ; de se réjouir des calamités publiques, de s’affliger du bon succès des affaires, et de souhaiter la ruine de l’empire. Tout cela, sur le fondement de ce qu’ils disaient de la vanité de toute la grandeur temporelle, de la fin du monde et du jugement ; et peut-être sur le rapport indiscret ou malicieux de ce qui est prédit dans l’Apocalypse, touchant la punition de Rome idolâtre, et la vengeance que Dieu ferait un jour du sang des martyrs. Ce qui confirmait cette calomnie, est qu’ils ne prenaient point de part aux réjouissances publiques, qui consistaient en des sacrifices, en des festins et des spectacles, pleins d’idolâtrie et de dissolutions. Au contraire, ils affectaient de passer ces jours-là dans l’affliction et dans la pénitence, en vue des péchés innombrables qui s’y commettaient, et ils se réjouissaient plutôt aux jours que la superstition des païens leur faisait compter pour lugubres et malheureux. Ils fuyaient même les foires, à cause des jeux qui s’y faisaient. S’ils y allaient, c’était pour acheter en passant, quelque chose de nécessaire à la vie, ou quelque esclave, afin de le convertir.
Enfin, c’était assez pour les rendre odieux au peuple, que la profession qu’ils faisaient de détester toutes les religions établies. Ils avaient beau dire qu’ils adoraient en esprit le Dieu créateur du ciel et de la terre, à qui ils offraient continuellement le sacrifice de leurs prières. Le peuple idolâtre n’entendait point ce langage ; il leur demandait le nom de leur Dieu, et les appelait athées, parce qu’ils n’adoraient aucun des dieux que l’on voyait dans les temples, puisqu’ils n’avaient point d’autels allumés, ni de sacrifices sanglants, ni de statues connues du peuple. Les sacrificateurs des idoles, les augures, les aruspices, les devins, en un mot tous ceux dont les professions étaient fondées sur le paganisme, ne manquaient pas de fomenter et d’exciter cette haine du peuple, et d’employer à cet effet les prétendus prodiges et les malheurs qui arrivaient, comme les stérilités, les mortalités, les guerres. Les chrétiens, disaient-ils, attiraient la colère des dieux sur tous ceux qui les laissaient vivre.
Par ces préventions, on empoisonnait jusqu’à leurs vertus. La charité qu’ils avaient les uns pour les autres, était une conjuration odieuse. Les noms de frères et de sœurs qu’ils se donnaient, étaient interprétés en mauvaise part, parce qu’en effet les païens en abusaient pour la débauche. Leurs aumônes passaient pour des moyens de séduire les pauvres, et les attirer à leur cabale, ou pour un effet de l’avarice des prélats, afin d’amasser dans les églises de grands trésors, dont ils pussent disposer. Leurs miracles étaient, disait-on, des maléfices et des impostures de magie. En effet, tout était plein de charlatans, qui se vantaient de prédire l’avenir par diverses sortes de divinations, ou de guérir les maladies par des caractères et des enchantements, par des mots barbares ou des figures extravagantes. Ils faisaient même des choses surprenantes pour tromper les yeux, soit par art, soit par opération du démon. Apollonius de Tyane est un exemple illustre. Ainsi on ne s’étonnait pas trop d’entendre raconter des miracles, ou même d’en voir ; on confondait les vrais avec les faux, et l’on méprisait également tous ceux qui passaient pour en faire. Le pays des apôtres et des premiers chrétiens aidait encore à cette erreur ; car la plupart de ces imposteurs venaient d’Orient.
Les persécutions mêmes étaient un sujet de haine contre les chrétiens. On supposait qu’ils étaient criminels, puisqu’ils étaient partout traités en criminels, et on jugeait de la grandeur de leurs crimes par la rigueur des supplices. On les regardait comme des gens dévoués à la mort, destinés au feu et aux gibets ; on leur en faisait des noms injurieux. Voilà ce qui rendait les chrétiens si odieux au peuple et aux ignorants ; voilà le fondement de ce qu’en disent Suetone et Tacite, suivant l’opinion commune. Suetone dit que l’empereur Claude chassa de Rome les Juifs, qui brouillaient sans cesse à la suscitation de Christ ; comme si Jésus-Christ eût été encore sur la terre, et ce fût rendu chef de parti entre les Juifs. Il compte entre les bonnes actions de Néron, d’avoir fait souffrir des supplices aux chrétiens, gens, ajoute-t-il, d‘une superstition nouvelle et malfaisante.
Tacite parlant du feu que Néron fit mettre à Rome pour se divertir, dit qu’il en accusa des gens odieux par leurs crimes, que le peuple appelait chrétiens : puis il ajoute, ce nom venait de Christ, que Ponce-Pilate avait fait supplicier sous l’empire de Tibère. Et cette pernicieuse superstition, arrêtée pour lors, s’élevait de nouveau, non-seulement par la Judée, source de ce mal ; mais à Rome même, où tout ce qu’il y a de noir et d’infâme dans le monde se rassemble et se pratique. On prit d’abord ceux qui avouaient, puis sur leur rapport une grande multitude fut convaincue, non pas tant de l’incendie, que de la haine du genre humain. Il les traite encore ensuite de coupables, et qui méritaient les derniers exemples.
Les gens d’esprit, et ceux mêmes qui entraient en quelque examen, avaient aussi leurs sujets d’aversion contre les chrétiens ; car ces gens d’esprit étaient des Grecs ou des Romains, accoutumés à mépriser les autres peuples, qu’ils nommaient Barbares, et surtout les Juifs, décriés, depuis longtemps, tenus pour des gens d’une superstition ridicule et d’une sotte crédulité. Un Juif le pourrait croire, dit Horace parlant d’un prodige, mais non pas moi. Ainsi quand on leur disait qu’il y avait des Juifs qui adoraient, comme fils de Dieu, un homme qui avait été pendu, et que leur principale dispute contre les autres Juifs était de savoir, si cet homme était encore vivant après sa mort, et si c’était leur véritable roi ; on peut juger de quelle absurdité leur paraissaient tous ces discours. Ils voyaient que ceux de cette nouvelle secte étaient haïs et persécutés par tous les autres Juifs, jusqu’à exciter souvent de grandes séditions : et de là ils concluaient que c’étaient les pires de tous.
On leur disait de plus, que ces gens n’employaient, pour persuader, ni raisonnements, ni éloquence ; qu’ils exhortaient seulement à croire les faits qu’ils avançaient, et qu’ils prétendaient confirmer par leurs miracles ; que la plupart étaient des ignorants, et n’étudiaient que les livres des Juifs : qu’ils faisaient profession d’instruire les ignorants comme eux, les femmes et le petit peuple ; parce qu’ils les trouvaient bien mieux disposés à recevoir leur doctrine, que les gens plus éclairés. Ce procédé était fort nouveau, car il n’y avait chez les païens aucune sort d’instruction pour le peuple. Les philosophes étaient les seuls qui parlassent de morale, et leurs disputes n’avaient rien de commun avec l’exercice de la religion. Enfin, comme tous les hérétiques passaient sous le nom de chrétiens, on attribuait à toute l’Église les rêveries des Valentiniens, et de tous ces visionnaires que saint Irénée a combattus ; les païens confondaient toutes ces extravagances avec la doctrine catholique, et le christianisme leur paraissait un entêtement de gens ignorants et opiniâtres.
À quoi bon, disaient-ils, quitter les religions établies depuis si longtemps avec de si belles cérémonies par l’autorité de tant de rois et de législateurs, et par le consentement de tous les peuples grecs et barbares, pour embrasser des mœurs étrangères, et vous intéresser à soutenir les fables judaïques ? Encore si vous vous faisiez Juifs tout à fait ; mais quelle extravagance de voûloir servir leur Dieu malgré eux, par un culte nouveau que les Juifs rejettent, et vous appliquer des lois qui ne vous conviennent point ?
Il est vrai que la morale des chrétiens était pure, et que leur vie répondait à leur doctrine. Mais tout était plein de philosophes, qui faisaient aussi profession de pratiquer la vertu ; et de l’enseigner. Il y en eut même plusieurs dans ces premiers siècles de l’Église, qui, peut-être à l’imitation des chrétiens, coururent le monde, prétendant réformer le genre humain, et souffrirent quelques mauvais traitements ; comme Apollonius de Tyane, Musonius, Damis, Epictète. Les philosophes étaient en grand crédit depuis plusieurs siècles ; on croyait qu’ils avaient tout dit, et on ne pouvait s’imaginer que des barbares pussent en savoir plus que Pythagore, Platon, ou Zénon. On croyait plutôt que s’ils avaient quelque chose de bon, ils l’avaient emprunté de ces sages si fameux.
D’ailleurs, les philosophes étaient plus commodes que les chrétiens. La plupart ne rejetaient point le plaisir ; et quelques-uns en faisaient le souverain bien. Ils laissaient chacun suivre son opinion et vivre à sa mode, se contentant de mépriser ceux qui n’étaient pas philosophes, et de s’en moquer. Le nombre des pyrrhoniens était grand. Ceux-ci doutaient de tout, principalement sur l’article de la divinité, si mal éclairci par les philosophes. Ils se faisaient une règle de sagesse de suspendre leur jugement, et trouvaient très mauvais que des ignorants, des gens du commun, tels qu’étaient la plupart des chrétiens, osassent décider sur une matière si relevée. Pour eux, ils faisaient profession de respecter les religions établies. Quelques-uns y croyaient, et donnaient des explications mystérieuses aux fables les plus ridicules ; d’autres, gardant pour eux la connaissance du premier Être, auteur de la nature, laissaient les superstitions à ceux qu’ils estimaient incapables de la sagesse. Les épicuriens mêmes qui se déclaraient le plus ouvertement contre les opinions populaires touchant les dieux, ne laissaient pas d’assister aux sacrifices, et de prendre part aux cérémonies de la religion des lieux où ils se trouvaient. Ils convenaient tous, de ne point combattre les coutumes autorisées par les lois et par les temps.
La créance de la pluralité des dieux s’étendait jusqu’à croire que chaque nation, chaque ville, chaque famille avait les siens, qui en prenaient soin, et voulaient y être honorés d’un culte particulier. Ainsi ils estimaient bonnes toutes religions, pour ceux chez qui elles étaient reçues depuis longtemps. Les femmes et le peuple, léger et ignorant, avaient toujours grande inclination à en embrasser de nouvelles ; croyant que plus ils serviraient de dieux et de déesses, et que plus ils observeraient de diverses cérémonies, plus ils auraient de religion. Les hommes graves et les politiques réprimaient cette inquiétude autant qu’il leur était possible, et ne voulaient aucun changement sur cette matière. Surtout ils condamnaient toutes les religions étrangères, et les Romains en faisaient un point capital de leur politique. Ils persuadaient au peuple que c’était à ses dieux tutélaires que Rome était redevable de ce grand empire, et qu’il fallait bien que ces dieux fussent plus puissants que les autres, puisqu’ils leur avaient soumis toutes les nations du monde. Aussi, quand le christianisme fut entièrement établi, les païens ne manquèrent pas d’attribuer à ce changement la chute de l’empire, qui le suivit d’assez près : et saint Augustin fut obligé de composer son grand ouvrage de la Cité de Dieu, pour répondre à leurs calomnies.
Le mépris que les chrétiens faisaient de la mort, n’étonnait pas beaucoup les païens Ils étaient accoutumés à voir des gladiateurs volontaires, qui, pour un petit intérêt, ou même pour rien, s’exposaient à se faire égorger en plein amphithéâtre. On voyait tous les jours les plus honnêtes gens se tuer eux-mêmes pour le moindre déplaisir, et il y avait des philosophes qui le faisaient par ostentation, comme disent les jurisconsultes. Témoin Pérégrin, dont Lucien rapporte la fin tragique. Ainsi, voyant que les chrétiens fuyaient les plaisirs de cette vie, et n’attendaient de bonheur que dans la vie future, ils s’étonnaient qu’ils ne se tuassent point. On nous dira, dit saint Justin, Tuez-vous donc tous, et vous en allez tout à l’heure trouver Dieu, sans nous embarrasser davantage. Et Antonin, proconsul d’Asie, voyant les chrétiens accourir en foule autour de son tribunal, pour se présenter au martyre, s’écria : Ah misérables ! Si vous voulez mourir, vous avez des cordes et des précipices.
Tout le peuple était donc contre les chrétiens ; le peuple, les magistrats, les ignorants, les savants ; ils étaient haïs des uns comme des imposteurs, des scélérats et des impies ; et méprisés des autres comme des misanthropes, des visionnaires et des fous mélancoliques, qu’une opiniâtreté enragée faisait courir à la mort. La prévention était telle, qu’on les condamnait sur le seul nom de chrétien, sans examiner davantage. Ce nom suffisait pour détruire tout le bien que l’on en savait d’ailleurs : et l’on disait communément : Un tel est un honnête homme, c’est dommage qu’il est chrétien. »
Lien vers le fichier PDF : https://lafrancechretienne.files.wordpress.com/2017/11/les_calomnies_lancees_contre_les_chretiens_v01.pdf