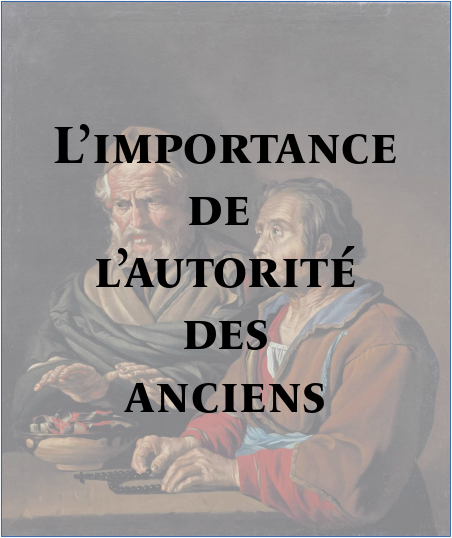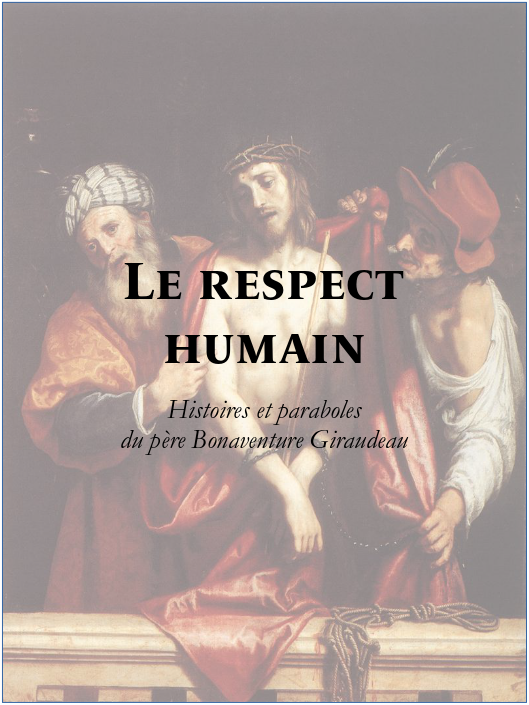XXXIVe lettre adressée à Carlo Bertinazzi
Un difficile conclave (qui élira Clément XIV)
Rome, 16 avril 1769.
Le 2 février dernier, à neuf heures du soir, et au moment où il allait se mettre au lit, le Saint-Père éprouva une convulsion violente, jeta un grand cri et expira.
Cette mort singulière occupe au loin les esprits : à Rome, on est surtout livré aux regrets d’une telle perte. Clément avait un zèle à toute épreuve, des mœurs d’or, une piété évangélique. Il commit sans doute des erreurs ; quelque imprévoyance de sa part causa une longue disette dans ses Etats ; sa résistance au sujet de Parme, sa bulle Apostolicam ont attiré sur l’Église plus d’une tempête ; mais il était averti lui-même du danger des conseils dont on l’avait environné ; et la veille même de sa mort était indiquée comme le jour d’ouverture de ce consistoire, où nous devions exposer nos avis.
Au lieu d’un consistoire, c’est un conclave qui est assemblé. Il y a déjà quarante jours que je suis sous le secret des murailles, et je ne prévois guère quand je serai libre d’en sortir. Quand cette lettre pourrait te parvenir avant la promotion du futur pontife, je n’essaierais pas de te dire qui l’on choisira. C’est toujours celui à qui on ne pense pas ; et cela est si vrai, que les Romains, accoutumés aux ambitions déçues et aux prophéties détruites, ont adopté ce proverbe : « Tel qui entre pape au conclave, en sort cardinal. »
Mon choix particulier est déjà fait. Le sacré collège offre dans ses membres plusieurs sujets dignes de ces périlleux honneurs ; mais le plus ferme et le plus sage à la fois est, à mes yeux, le cardinal Corsini. Ce n’est pas lui qu’on désigne ; c’est un prince romain de l’illustre famille des Chigi.
Jamais prince, quel qu’il soit, n’aura été élu dans un temps plus désastreux. L’Espagne, mécontente, ne dissimule point ses ressentiments contre notre cour ; Louis XV est en possession du comtat d’Avignon ; Naples retient une autre partie de notre territoire ; Venise prétend réformer ses moines sans recourir à l’autorité du Saint-Siège ; la Pologne veut diminuer les privilèges de la nonciature ; le Portugal menace de se donner un patriarche, et de ne plus communiquer avec nous que par la voie des prières ; les Romains murmurent eux-mêmes de voir se séparer d’eux les étrangers ; et enfin l’esprit de vertige qui travaille ce siècle ébranle à la fois les pontifes, les monarques et le christianisme !
Les jésuites, intéressés plus que tout autre corps religieux, dans un embarras dont ils sont la principale cause, intriguent ouvertement pour que l’Église ait un chef à leur dévotion. Je ne fais pas de vœux pour leur succès ; mais sans passion comme je le suis ici, sans engagement avec personne, sans préoccupation d’aucune espèce, sans ambition, même celle de voir triompher ce que je crois le meilleur parti, je suis placé on ne peut mieux pour observer. J’ai du loisir ; souvent j’en ai beaucoup trop ; je me délasse de cette oisiveté en contemplant la scène mobile qui s’embrouille, se dénoue, se renoue vingt fois par jour. Si quelque écrivain philosophe était, comme moi, spectateur, que d’utiles observations ne pourrait-il pas faire sur le cœur des hommes ? J’en demande pardon à mes confrères ; mais leur gravité même n’exclut pas toujours les traits facétieux. Un poète comique tirerait parti de plus d’une chose dans un conclave : votre Molière y eût recueilli des traits excellents.
Sais-tu ce que c’est qu’un conclave ? Une réunion de vieillards, moins occupés du ciel que de la terre, et dont quelques-uns se font plus maladifs, plus goutteux et plus cacochymes qu’ils ne le sont encore, dans l’espérance d’inspirer un vif intérêt à leurs partisans. Grand nombre d’Éminences ne renonçant jamais à la possibilité d’une élection, le rival le plus près de la tombe excite toujours le moins de répugnance. Un rhumatisme est ici un titre à la confiance ; l’hydropisie a ses partisans : car l’ambition et la mort comptent sur les mêmes chances. Le cercueil sert comme de marchepied au trône ; et il y a tel pieux candidat qui négocierait avec son concurrent, si la durée du nouveau règne pouvait avoir son terme obligatoire comme celui d’un effet de commerce. Eh ! Ne sais-tu pas toi-même que le pâtre d’Ancône brûla gaiement ses béquilles dès qu’il eut ceint la tiare ; et que Léon X, élu à trente-huit ans, avait eu grand soin de ne guérir d’un mal mortel que le lendemain de son couronnement ? Nier que la cabale et la ruse aient une entrée au sacré collège, ce serait démentir l’évidence, ce serait contredire l’histoire de tous les temps.
Nous sommes donc enfermés : chacun a sa cellule ; toute communication est interdite avec le dehors. Un tel usage date déjà de loin ; il remonte à 1270, époque de l’élection de Clément IV. Les cardinaux étaient alors rassemblés à Pérouse et depuis six mois. Les bourgeois de la ville, apprenant que leurs hôtes allaient se séparer, faute de pouvoir conclure, s’opposèrent de force au départ ; murèrent, selon toute la rigueur du mot, les issues de l’église où délibéraient les porporati, et les forcèrent ainsi à une promotion. Ce fut celle de Guido Fulcadi, ce Clément IV, de modeste mémoire.
Quand les conclaves s’assemblent en été, la chaleur, le manque d’air, le voisinage immédiat de tant de personnes sont, dit-on, insupportables : dans ce mois-ci, l’aria cattiva est moins redoutable ; et cependant je me sens déjà une sorte de malaise. Il est causé sans doute par la privation d’exercice et le manque de mes livres, condition si essentielle de ma vie. Les premiers jours c’était un tumulte, dans les corridors, à ne s’entendre pas jusqu’au milieu de la nuit. L’un se débattait contre le Maréchal de l’église, ou contre le cardinal Camerlingue, afin d’introduire, pour le service de sa personne, plus de gens que les règlements ne le comportent ; un autre faisait poser des tapis, une cheminée postiche et ses armoiries pour orner un réduit en planches de dix palmes carrées. C’était à qui, outre ces deux conclavistes et les serviteurs communs du collège, aurait un maître-d’hôtel et sa livrée. Celui-ci voulait son épinette, et celui-là son perroquet ; le cardinal T. abandonnait tous les privilèges qu’il pouvait réclamer, pourvu que son cuisinier s’enfermât avec lui.
Nous avons déjà trois factions : les POLITIQUES, LES DÉVOTS et LES INDÉCIS. On me fait l’honneur de me ranger dans la première de ces classes. Les plaisanteries sont ici de mode dans les murs, comme hors des murs. Le cardinal doyen m’a demandé, en présence de cinq ou six de nos confrères, si je voulais être élu.
« Le temps, ai-je dit, n’est pas favorable aux Religieux, et Sixte-Quint a usé les ressources de l’humilité en s’en faisant un jeu. D’ailleurs, vous êtes en trop petit nombre pour me choisir, et vous êtes trop pour avoir mon secret. »
Ainsi le temps s’écoule en discours puérils, ou en intrigues. Le cardinal Quirini avait bien raison de comparer un conclave à une ruche d’abeilles : ceux-là piquent, ceux-ci bourdonnent ; on emploie tour à tour, pour composer le miel, le baume et l’absinthe.
Ces jeunes abbés de toutes nations, tenus à Rome en expectative, ont brigué à l’envi les places de conclavistes : les plus gentilshommes d’entre eux n’ont pas dédaigné un emploi qui tient beaucoup aux fonctions de serviteurs. J’ai cédé, pour ma part, aux instances d’un petit-collet français, M. l’abbé Néraud, le plus jovial gascon qui porte la tonsure : lui, et le frère François, mon compagnon inséparable, voilà toute ma cour et toute ma maison. Cette maison est sur un pied de sobriété qui a un peu étonné le compatriote de M. de Bernis. Dès le second jour de réclusion, il s’est glissé dans les offices du cardinal T., lassé qu’il était de partager mon repas ordinaire : un peu de fenouil et deux grives maigres. Et comme je lui faisais remarquer que peut-être on attribuerait son assiduité chez le cardinal à quelques menées qui sont interdites entre nous, il m’a rassuré par l’aveu que Son Éminence ne le consultait que sur des consommés et sur une sauce à la française qu’il avait résolu de perfectionner. Je crois, en effet, que mon Français ne se laisse point corrompre ; car il a joué à son patron de gourmandise un tour dont on rit encore dans plus d’une cellule. Ce pauvre cardinal T. n’aspire pas à la triple couronne ; mais il voudrait bien être secrétaire-d’État, parce qu’il est persuadé qu’un homme comme lui concilierait beaucoup d’affaires autour d’une table. Or, comme il y a deux partis qui dominent ici, l’un en faveur des jésuites, l’autre en faveur des princes de la maison de Bourbon, le cardinal avait composé deux mémoires en sens opposés, et désirait qu’ils parvinssent aux deux concurrents qui ont le plus de chances. Que fait-il ? Ne pouvant leur remettre, ni leur envoyer ostensiblement ces papiers, il a imaginé de les enfermer dans une enveloppe innocente. J’ai entendu parler d’une galantine et d’un pâté : il aurait chargé l’abbé Néraud du double message ; mais, soit distraction, probité ou malice, l’abbé se serait trompé ; et les raisons du cardinal, pour supprimer une société dont Ricci est général, seraient arrivées entre les mains du plus fidèle appui de la congrégation.
Tout n’est pas plaisant dans cette assemblée : il s’y trame d’odieux complots. La corruption ouvre les portes les mieux fermées : les ambassadeurs luttent de prétentions, de promesses ou de menaces autour du collège. Il y en a qui auraient recours aux plus obscurs appuis. Les trônes où siègent des Bourbons se distinguent par leur colère envers les enfants de Loyola. Avant-hier, mon confrère de Bernis me félicitait sur ce qu’étant professeur de philosophie, j’avais autrefois combattu les doctrines de la Société ; et il ajouta que sa cour en était informée par je ne sais quel religieux du comtat Vénaissin : ce religieux se serait procuré quelques-unes de mes lettres, et en aurait communiqué le contenu. Je ne comprends guère toute cette police ecclésiastique, mais ce qu’il y a de singulier, c’est que M. de Bernis poursuit avec persévérance un système qui contrarie ses affections : cardinal, il aime les jésuites ; envoyé de France, il sollicite leur destruction.
On nous prédit que le conclave durera trois mois : je commence à le craindre, voyant tant d’intérêts se croiser, tant de rivalités inconciliables. Comment réunir deux tiers des voix en faveur d’une seule personne ? Chaque jour, un calice déposé sur l’autel où chacun va porter son scrutin, se vide sans donner de solution. Le jour suivant recommence par une messe du Saint-Esprit, et se termine par des repas où la frugalité des apôtres n’est pas toujours observée. Mon oracle à moi, sur la durée de ce conclave, est un vieux domestique qui en a déjà vu cinq ; quelques cardinaux voulant, par plaisanterie, lui faire, croire ce matin que l’élection était faite :
« Je gagerais que cela n’est point, dit-il, car, dans le trouble que vous cause toujours la création d’un pape, vous ne manquez jamais de m’appeler Éminence, moi qui ne suis qu’un pauvre serviteur à deux pistoles par jour. »
Un de nos plus anciens chapeaux, personnage bègue, et jusqu’ici peu accusé d’ambition, proposait tout-à-l’heure qu’on remît l’élection à sa voix : quelques-uns semblaient disposés à consentir, pour abréger les lenteurs, quand Monsignor Boroméo s’est avisé de demander au médiateur s’il connaissait l’Histoire de Jean XXII : les joues du pauvre cardinal se sont couvertes de pourpre ; et tout le monde s’est rappelé, en riant, que Jean XXII (le cardinal d’Ossat) reconnut la confiance du conclave de 1314, en se donnant à lui-même la couronne. Ce dut être une scène bizarre que ce moment où toutes les oreilles, attentives aux paroles de d’Ossat, entendirent prononcer gravement la formule par laquelle il se faisait Pape : Ego sum Papa !
Cette lettre, dont je trace chaque jour quelques lignes, mon cher ami, ne finirait pas si je voulais te confier tout ce qui étonne mes yeux, et tout ce qui me serre le cœur. Tantôt la faction française nous propose des choix ridicules pour amuser le tapis, selon l’expression qu’ils emploient. Les zelanti (nouvelle faction) jurent qu’ils resteront six mois enfermés plutôt que de se départir de leur prédilection pour le cardinal Stroppani. Tel joue l’indifférence, et tel se fait malade. Celui-ci a cinq voix acquises, l’autre sept.
« Combien en voulez-vous ? À quel prix céderiez-vous vos voix ? » se dit-on ingénument. Le soir, des espions écoutent aux portes ; et, bien que quelques-uns aient déjà reçu des avertissements et même des coups de canne, cette pratique se renouvelle. On dit même que certains ambitieux ne redoutent pas les périls de cette exploration, pourvu qu’ils soient informés de ce qui peut seconder leurs vues.
Hier, on a enfoncé une cellule, parce qu’un de nos confrères refusait de venir voter. L’ennui menace quelquefois de les vider toutes, ces cellules ; et quelquefois on pense à faire entrer ici le Maréchal pour y rétablir l’ordre et la paix. Une ouverture, pratiquée durant la nuit dernière dans la muraille qui nous sépare du grand cloître, a été découverte. Cet événement donne un vaste champ aux suppositions de toute espèce ; la plus vraisemblable est que la cupidité de quelques voleurs a été excitée par l’immense argenterie que les cardinaux ont fait entrer ici pour leur service. Tant qu’on a pu échanger des conjectures sur ce sujet, et venir voir murer cette ouverture, la vie, le mouvement, l’intérêt de l’existence ont été rendus à un grand nombre de personnages.
On tend des pièges à ceux d’entre nous qu’on ne juge pas assez dévoués aux intérêts jésuitiques. Il faut détruire toutes leurs chances à la promotion. Jusqu’à moi, on cherche à me compromettre ! On m’est venu raconter que plusieurs jésuites français réfugiés dans le duché d’Urbin, mon pays, étaient en butte à la misère. J’ai écrit là-dessus à plusieurs personnes charitables, et je sais qu’on a intercepté mes lettres pour montrer aux agents de Louis XV que je n’étais pas ce que l’on croit.
Hélas ! Mon pauvre Charles, qu’on est affligé de voir tant de puérilités, de ruses, de perfidies mondaines, de passions, d’équivoques et de mauvaise foi ! Je plains les électeurs un peu profanes de ce pontife, dont l’enfantement est si laborieux : je ne puis nullement prévoir qui sera l’objet de leur choix, j’aurais presque dit leur victime.
Lien vers le fichier PDF : https://lafrancechretienne.files.wordpress.com/2017/09/un_difficile_conclave_clement_xiv.pdf