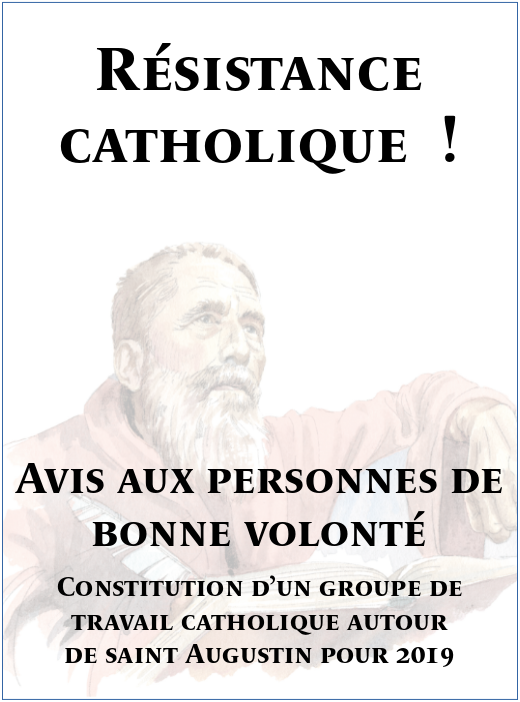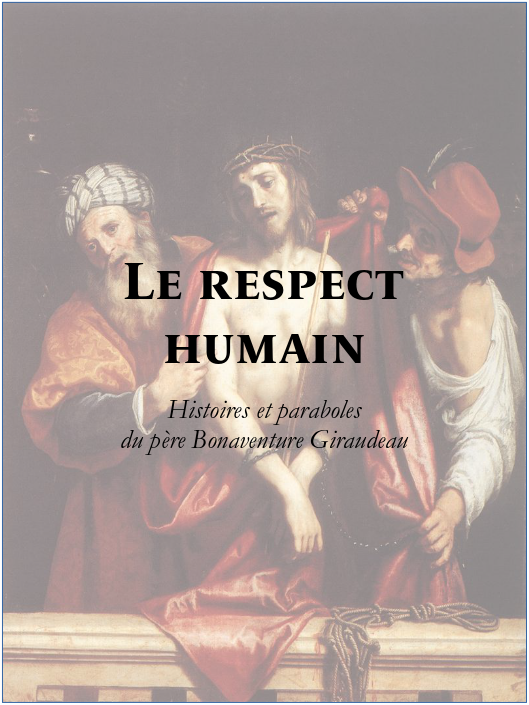Chers amis,
Le progrès technique sert une cause inique qui ne sera jamais dévoilée par l’ennemi. De génération en génération, l’évolution technologique est le moyen qui permet à une caste, se croyant supérieure, de s’emparer du pouvoir politique. En effet, l’homme se fait facilement tromper en suivant de fausses lumières.
Au lieu de se préoccuper de la gravité de la décadence qui s’empare de notre civilisation, le quidam se fait emporter par le torrent et finit par perdre pied. Nous sommes tous concernés par la dégénérescence qui sévit en ce siècle de perdition. Nous sommes tous ce quidam.
Du temps de Jésus-Christ, les Hébreux essayaient du mieux que possible d’honorer le vrai Dieu unique. Il s’agit d’un Dieu qui a donné l’espoir et la joie à un peuple qui, finalement, n’a pas reconnu Le Sauveur.
Après le refus du Christ sur terre, les hommes se sont égarés dans les guerres. De nouvelles religions ennemies les unes des autres émergeaient et souhaitaient s’emparer du pouvoir absolu. L’histoire n’a fait que confirmer cette terrible réalité. L’homme préfère les histoires temporelles aux histoires spirituelles. Au lieu de suivre la voie droite, il se fait influencer par un ennemi invisible qui l’entraîne dans les abîmes.
Jésus-Christ dit, par delà les siècles : « qui ne rassemble pas avec Moi disperse ». Cette Parole est si vraie que de nos jours, les religions monothéistes semblent disloquées dans leurs contradictions. L’Église nous donne toujours l’espoir de temps meilleurs mais à quel prix ! La corruption de l’ennemie s’est immiscé à la tête du corps matériel de l’Église. Comme disait saint Augustin : « lorsque la tête est corrompue, c’est l’ensemble du corps qui risque la putréfaction ».
Si nous voulons survivre aux temps qui viennent, nous devons suivre la voie droite et étroite de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Si nous voulons rassembler et Lui ressembler, nous devons L’aimer et appliquer Ses commandements. Nous ne pouvons ni être quiétistes ni jansénistes.
D’une part, les quiétistes se contentent d’admirer un Dieu dans leur esprit, en n’appliquant aucune de ses lois, mais, au contraire, en se laissant flatter par les sens. Les quiétistes sont donc comme ces hommes qui restent assis pendant que le monde passe. Ce sont de faux religieux qui essayent de faire oublier les Dix commandements de Moïse. Car, ne l’oublions pas, nous sommes toujours soumis à la Loi. Mais, celle-ci a été réformée par Notre-Seigneur. Nous devons suivre les dix commandements en appliquant en priorité les deux principaux :
- Tu aimerais Dieu de toutes tes forces et de tout ton cœur.
- Aimer Dieu de tout son cœur et de toutes ses forces signifie qu’il est indispensable de rejeter le blasphème. La crainte de Dieu doit guider le cœur de l’homme droit, de manière humble et sincère.
- Tu aimerais ton prochain comme toi-même.
- Aimer son prochain comme soi-même consiste à considérer l’être humain qui est là, en face de soi, comme un frère qui est soumis aux mêmes défauts. On doit essayer de voir en lui ce qu’il y a de mieux. On doit lui porter secours, à chaque fois que nécessaire, comme le ferait le Bon Samaritain. Un frère se doit de protéger son propre frère.
De ces deux Lois, améliorées par Jésus-Christ, qui sont elles-mêmes issues de la Loi de Moïse, nous devons en tirer d’autres conclusions :
- Vous êtes tous frères et il n’y a qu’un seul Dieu.
- Nous sommes tous issus de la création du vrai Dieu unique. A ce titre, nous sommes tous frères et personne n’a le droit de reprocher à l’autre d’être différent. Dieu nous a tous donné des qualités et des caractéristiques que nous devons accepter et défendre. Le racisme et l’anti-racisme sont les deux faces d’une même pièce qui sert la cause du diable et de ses sbires qui sévissent ici-bas, à côté de nos frères en Christ. Toute idéologie essaye de nous détourner de la vraie foi pour nous faire admirer une idée défigurée par le sophisme. Le mensonge diabolique consiste à nous faire aimer autre chose que Dieu. Dès lors, nous perdons de vue l’amour de Dieu et de notre frère. Le diable parvient à nous arracher la Vérité, puisque, l’authentique trésor est avant tout céleste.
D’autre part, les jansénistes sont des prêtres rigoureux au point de faire perdre la foi en un Dieu d’Amour. Pour eux, le libre-arbitre n’existe pas puisqu’il n’y aurait que des élus et des réprouvés. Dieu ne serait alors que rigueur et châtiment à l’image d’un faux dieu cruel et barbare. Il s’agit bien sûr d’un odieux blasphème qui a contribué à la disparition de la vraie foi. Car la foi doit nous rendre semblable à l’apôtre du Christ, c’est-à-dire généreux, doux, juste et aimant. Le jansénisme annonçait déjà une terrible apostasie.
Au fil des siècles, le progrès a détourné les catholiques européens de la véritable foi. Le français du XVIIIe siècle, par exemple, visait le progrès comme but ultime. Le Christianisme a autorisé la recherche et la découverte, que nous nommons couramment « progrès ». Or, par un effet issu de lois invisibles qui nous sont supérieures, le progrès technologique a donné naissance à deux frères :
- L’athéisme
- L’athéisme a créé dans le cœur de l’homme une faille béante. Lorsque l’on ne croît pas en Dieu, on croit en soi-même. On devient son propre « dieu ». On se considère comme le nombril du monde. Dès lors, le prochain n’est plus rien sinon un concurrent ou encore pire, un gêneur. L’athéisme est le terreau de l’esprit de compétition et de l’individualisme. Lorsqu’un peuple n’est plus uni, il est dispersé à l’image des Hébreux qui ont erré pendant des millénaires parmi les nations. Souvenons-nous des paroles du Christ : « Qui n’assemble pas avec Moi disperse ». L’athéisme est le fruit d’un travail de sape constant qui tend de nos jours à être amplifiée par la société de consommation et l’Internet. Les médias s’acharnent à effacer toutes traces des Lois de Moïse et de la foi en Jésus-Christ en diffusant des séries et des films de plus en plus nombreux. Cette technique consiste à diluer la Vérité dans le mensonge. Autrement dit, cela peut être comparé à la dissolution d’une goutte d’eau minérale, la Vérité, dans un grand verre d’eau souillée par la boue, le mensonge.
- Le matérialisme
- Le matérialisme est indispensable à l’athéisme pour se maintenir. Le matérialisme est une illusion qui remplace l’espoir. Au lieu d’attendre patiemment, on se précipite dans les supermarchés pour acheter l’objet de son désir qui semble calmer un certain vide. Or, en achetant un objet, on contribue, au contraire, à renforcer l’effet du matérialisme puisque l’on enrichit les milliardaires. Ce cercle vicieux encourage les hommes riches à produire davantage. Le matérialisme sévit à travers les primes, les salaires, les objets, les vacances, etc. Le matérialisme correspond à un marché mondial parmi lequel, un jour ou l’autre, l’homme sera lui-même réduit à l’état de marchandise. Le matérialisme est comparable à une tyrannie cachée qui rend esclave les hommes sans que ceux-ci en soient conscients. Nous pouvons être comparés à des animaux élevés en cage, qui n’ayant jamais connu la liberté, se contentent de vivre dans une société étouffante et violente en acceptant ses codes immoraux.
Nous pouvons constater que saint Augustin, et les autres saints, avaient tant raison ! Le péché détruit la vertu et entraîne l’homme vers la perdition. C’est comme si nous préférions, encore et toujours, Barabbas à Notre-Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, comme dit Jésus-Christ : « Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. »
Le monde va à sa perdition à une allure de plus en plus rapide. Le catholicisme du XIXe siècle a cédé la place à l’athéisme du XXe siècle. En ce XXIe siècle, l’Islamisme, qui est une branche sunnite radicale de l’Islam, va engendrer de multiples guerres sanglantes sur notre territoire. La France est en train de subir la Justice de Dieu en tombant dans les griffes du despotisme. Celui qui dirige la France en 2020 est un poteau de boue, comme disait Marie-Julie Jahenny. Nous ne devons rien attendre de lui puisqu’il obéit à ses maîtres qui haïssent la France. Ne soyons pas dupes, l’ennemi attend le moment propice pour anéantir les infidèles à l’aide d’armes plus ou moins lourdes. Le châtiment de la France sera terrible. Les villes de Paris, Marseille et Lyon seront anéanties dans un chaos terrifiant. L’Assemblée Nationale, qui est devenu le lieu d’adoption de lois iniques, finira sous un déluge de feu.
Ce qui semble aujourd’hui impossible aura pourtant bel et bien lieu. La France doit être châtiée pour que la foi en Jésus-Christ puisse renaître dans le cœur d’hommes sages. Parce que ceux-ci auront su que la Vérité était en Christ et nulle part ailleurs. Jésus-Christ nous a prévenu de tout ceci et ses prophéties sont en train de se réaliser, en ce siècle terrifiant :
« Jésus leur répondit : « Prenez garde que personne ne vous égare. Car beaucoup viendront sous mon nom, et diront : “C’est moi le Christ” ; alors ils égareront bien des gens. Vous allez entendre parler de guerres et de rumeurs de guerre. Faites attention ! ne vous laissez pas effrayer, car il faut que cela arrive, mais ce n’est pas encore la fin. On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume ; il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Or tout cela n’est que le commencement des douleurs de l’enfantement. Alors, vous serez livrés à la détresse, on vous tuera, vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Alors ce sera pour beaucoup une occasion de chute ; ils se livreront les uns les autres, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de faux prophètes se lèveront, et ils égareront bien des gens. À cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira. Mais celui qui aura persévéré jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé. Et cet Évangile du Royaume sera proclamé dans le monde entier ; il y aura là un témoignage pour toutes les nations. Alors viendra la fin. »
Nous savons que nous devrons reconstruire une France détruite par la folie des hommes. Pour la reconstruire, nous devrons nous atteler, tels des apôtres, aux prêches et aux sermons afin que la France retrouve sa grandeur d’autrefois. C’est par la Charité que nous pourrons sauver la France et non pas par les folies guerrières. Celui qui dit « œil pour œil et dent pour dent » n’est pas plus sage que celui qui affirme que Jésus-Christ n’existe pas.
Il est, bien sûr, plus facile de haïr que d’aimer, mais, c’est là, la juste mesure de la Justice : nous sommes le sel de la terre et à ce titre nous devrons réapprendre à nous aimer les uns les autres, grâce aux commandements de Dieu. Le Christ-Roi doit s’asseoir de nouveau sur le trône de France pour que notre nation puisse sortir de l’enfer. Tant que nous serons tièdes, nous ne pourrons pas nous affermir et le sol sera d’argile, ce qui nous conduira à la ruine :
« Alors je leur déclarerai : “Je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal !” Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison ; la maison ne s’est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison ; la maison s’est écroulée, et son écroulement a été complet. »
Chers amis, peu importe que vous croyez ou non à ces paroles puisque la Vérité nous a été enseignée par Jésus-Christ. Ses paroles sont éternelles et résonnent plus que jamais dans le temps. Si nous voulons que la France vive, nous devrons tôt ou tard partir au combat. Ce combat sera celui de David face à Goliath. Autrefois, les saints emmenaient les troupes catholiques chanter en procession pour invoquer la Sainte-Vierge Marie, saint Michel Archange et Jésus-Christ. Ainsi, le Ciel leur octroyait la protection nécessaire. Nous devrons partir dans ce même type de combat : c’est en invoquant le Ciel que nous pourrons vaincre. Nous devons croire que nous avons déjà gagné pour que Dieu nous donne la victoire sur le mal. C’est par une foi ferme et indestructible que nous pourrons rétablir l’Autel et le Trône.
En attendant ces terribles moments de guerre et de sang, je vous prie de bien vouloir prier la sainte Famille pour qu’Elle protège ce qui reste de la France. « Jésus, Marie, Joseph » est l’un de nos credo. Souvenons-nous que la sainte famille est constituée d’un homme, d’une femme et d’un ou plusieurs enfants. Un père ne sera jamais une femme. Une mère ne sera jamais un homme. Il n’existe que deux sexes, le règne animal nous l’a toujours prouvé. L’homme obtient un enfant en se mariant avec son épouse. Un couple de deux êtres identiques est voué à la stérilité puisque Dieu a crée Adam et Ève. Le système contemporain essaye de détruire notre foi. Or, nous avons bâti notre maison sur le Roc. Nous croyons et croirons toujours aux vérités bibliques et nous piétinerons la censure et le mensonge.
Il faudra, un jour ou l’autre, rétablir la Vérité et contraindre l’humanité à honorer Dieu et à craindre le mensonge en utilisant une verge de fer. C’est certainement le rôle du futur roi de France qui sera à la foi doux et dur. Il se peut que ce soit un homme à deux visages : doux avec les faibles et terrifiant avec les forts. Dès lors, il serait une source de malheur pour les méchants et une source de bonheur pour les affligés. Il est prophétisé qu’il vaincrait les méchants en leur menant la guerre. C’est à ce titre qu’il est perçu, par les sectes maçonniques, comme un antéchrist ennemi de leur foi dévoyée. Car, pour les illuminés maçonniques, leur roi ne peut être qu’un antichrist qui haït Jésus-Christ. Or, les termes antéchrist et antichrist ne sont pas similaires. L’antéchrist vient avant le Christ tandis que l’antichrist est l’ennemi du Christ. Selon les prophéties, le roi de France serait un homme aimant Dieu et haïssant le péché, tandis que l’antichrist viendrait après lui pour anéantir le monde. Attention : ces propos ne sont que des hypothèses établies selon les études de textes prophétiques et ne sauraient en aucun cas être une source de vérité absolue.
Dans tous les cas, nous obtiendrons la victoire en ayant foi en la vérité des Évangiles. Dieu nous a donné le livre de la Vérité. A nous de croire pour relever la France de la fange contemporaine. Le rétablissement des dix commandements et de la foi en le Christ-Roi sont indispensables à notre nation si nous souhaitons lui éviter la disparition.
Que Dieu vous bénisse et vous protège en ces temps d’affliction.
Stéphane
22 février 2020
Lien vers le fichier PDF : https://lafrancechretienne.files.wordpress.com/2020/02/la_france_sera_chatiee_tant_qu_elle_refusera_le_christ_roi_v01.pdf