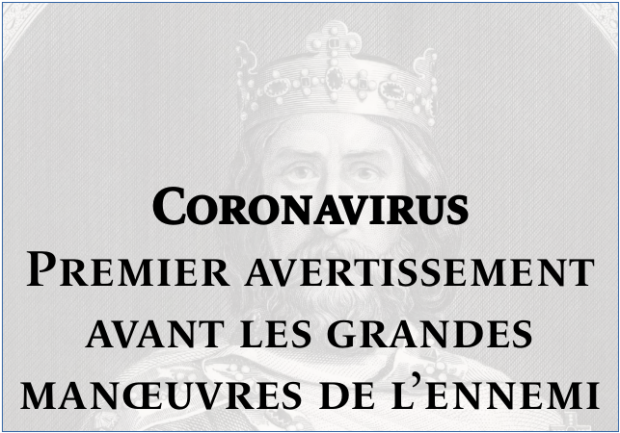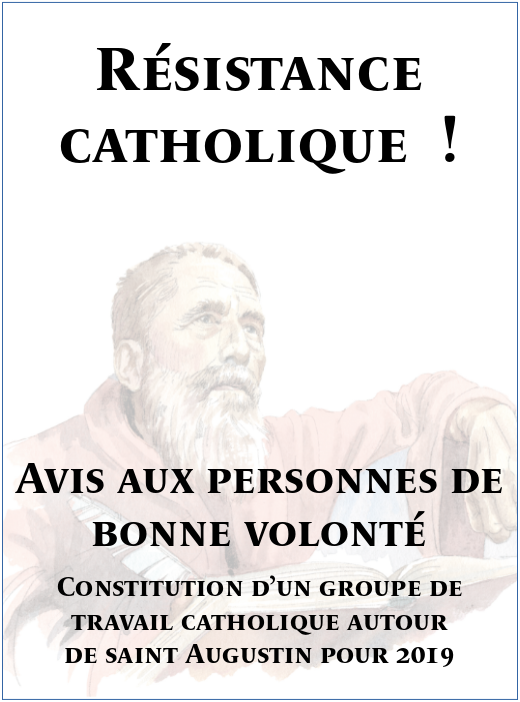Chers amis,
Je reprends la plume pour essayer de faire le point sur la situation actuelle. Le niveau d’anxiété est à son comble avec un coronavirus qui ne tue que quelques personnes dans le monde.
Le confinement forcé pour éviter la pandémie fait penser à une technique de manipulation de masse formidablement bien orchestrée. Après la crise, le gouvernement pourrait annoncer qu’il a sauvé la vie des français, mais, s’il n’y a pas eu de morts, comment le savoir ?
Posons-nous plusieurs questions :
- Où se trouve la pandémie ?
- A-t-on des preuves de la dangerosité du covid19 ?
- Est-ce que le nombre de morts causés par ce virus auraient été sous-estimés ou sur-estimés ?
- Pourquoi est-ce que le gouvernement demande aux policiers et aux médecins de ne porter ni masques ni gants ?
- Pourquoi est-ce qu’une ministre annonce que l’État donnera 100 000 masques aux prisonniers tandis que la population, les médecins, les militaires et les policiers n’en auraient pas ?
- Pourquoi est-ce que le gouvernement laisse s’effectuer les braquages de masques ?
- Pourquoi est-ce que certains ministres annoncent qu’il faut s’attendre à une contamination à hauteur de 70 % de la population avec un taux de mortalité à 8 % pour les personnes à risques ?
- Finalement, est-ce que le but ne serait pas de faire circuler le virus de la peur en vue d’engendrer le chaos ?
On entend, de ci et de là, toutes sortes de théories difficilement prouvables :
- Certains disent que le virus est mortel et que le le vaccin coûterait très cher.
- D’autres annoncent qu’au contraire il s’agit de l’agenda 2030, ID2020, de Accenture et Microsoft en vue d’imposer un vaccin obligatoire, potentiellement mortel à long terme et contenant une puce, qui devrait être injecté de force sous contrôle militaire et policier.
- Des théories annoncent l’instauration d’un état d’urgence sanitaire dans le but de détruire le salariat.
- Certains parlent même de complots maçonnique, sioniste, britannique, ou chinois, peut-être américain, finalement russe ou iranien, et même sunnite, voire extra-terrestre, etc.
Nous savons grâce aux Évangiles que :
- Le but de Satan est de semer la terreur et la perte de la foi dans les âmes parce qu’il est le prince du mensonge, le chef des puissances infernales qui rodent tels des lions pour dévorer leurs proies.
- Le pouvoir de Satan est limité par Jésus-Christ, la Sainte Vierge Marie, saint Michel Archange et sa milice céleste.
Dès lors, avançons quelques hypothèses réfléchies qui, toutefois, ne sont pas plus valables que les autres :
- Un gigantesque scandale sanitaire se profile.
- Après le confinement, le gouvernement aurait la légitimité pour réduire les vacances scolaires, augmenter le temps de travail jusqu’à 48 heures selon la loi européenne, diminuer ou éliminer les RTT et éventuellement détricoter la 5ème semaine de congés payés.
- Jacques Attali avait annoncé que le nationalisme aurait le vent en poupe en 2022, en nommant à mi-mot Marion Maréchal. Est-ce que le but du gouvernement serait de se saborder, à cause de son amateurisme proclamé et son incroyable opportunisme, pour donner le profit au Rassemblement National ? Les politiciens de ce parti sortent de leur silence pour envoyer les membres de ce gouvernement devant les tribunaux.
Dans tous les cas, nous nous dirigeons vers une crise socio-politico-économique de très grande ampleur qui risquerait d’engendrer une guerre de tous contre tous.
Les prophéties de Marie-Julie Jahenny annoncent que les mois de mai et de juin, lors d’une certaine année, seraient marqués par la colère de travailleurs désœuvrés arpentant les villes.
L’armée serait occupée à l’étranger et la police en sous-effectif.
Les ennemis de la France sont fabriqués, drogués et armés par les gouvernements successifs depuis Mitterrand. Nous parlons de ces mafias qui sont parquées dans les zones de non-droit. Leurs membres islamistes en profiteraient pour lancer une guerre civile en vue d’aboutir à la Charia.
Si ces événements arrivaient, voici ce que les prophéties annoncent :
- Le gouvernement français ferait comme l’oiseau, c’est-à-dire qu’il s’enfuirait en laissant la France sans gouvernance.
- La Russie, l’Iran et la Chine pourraient être forcés d’intervenir, en été, pour stopper le chaos en Europe.
- La monarchie serait restaurée par trois fois.
- C’est seulement le troisième roi qui serait consacré au Sacré-cœur de Jésus.
- Le roi du Sacré-cœur rétablirait la religion et la monarchie selon les commandements de Jésus-Christ en consacrant la France au Christ-Roi.
Le but de Satan est de nous faire perdre la foi, l’espérance et la charité en vue de nous prendre dans ses filets.
Dans ce chaos ambiant, prions plus que jamais.
Il nous faut garder les vertus théologales (la foi, l’espérance et la charité) et cardinales (prudence, tempérance, force d’âme et justice) puisque Dieu, notre Père, veille.
Il semblerait que nous soyons en train d’assister à « l’abomination de la désolation » prophétisée par Daniel. Lisez l’Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 24:15 ainsi que les versets suivants.
« 15 Lorsque vous verrez l’Abomination de la désolation, installée dans le Lieu saint comme l’a dit le prophète Daniel – que le lecteur comprenne ! –
16 alors, ceux qui seront en Judée, qu’ils s’enfuient dans les montagnes ;
17 celui qui sera sur sa terrasse, qu’il ne descende pas pour emporter ce qu’il y a dans sa maison ;
18 celui qui sera dans son champ, qu’il ne retourne pas en arrière pour emporter son manteau.
19 Malheureuses les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là !
20 Priez pour que votre fuite n’arrive pas en hiver ni un jour de sabbat.
21 Alors, en effet, il y aura une grande détresse, telle qu’il n’y en a jamais eu depuis le commencement du monde jusqu’à maintenant, et telle qu’il n’y en aura jamais plus.
22 Et si le nombre de ces jours-là n’était pas abrégé, personne n’aurait la vie sauve ; mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés.
23 Alors si quelqu’un vous dit : “Voilà le Messie ! Il est là !” ou bien encore : “Il est là !”, n’en croyez rien.
24 Il surgira des faux messies et des faux prophètes, ils produiront des signes grandioses et des prodiges, au point d’égarer, si c’était possible, même les élus.
25 Voilà : je vous l’ai dit à l’avance.
26 Si l’on vous dit : “Le voilà dans le désert”, ne sortez pas. Si l’on vous dit : “Le voilà dans le fond de la maison”, n’en croyez rien.
27 En effet, comme l’éclair part de l’orient et brille jusqu’à l’occident, ainsi sera la venue du Fils de l’homme.
28 Selon le proverbe : Là où se trouve le cadavre, là se rassembleront les vautours.
29 Aussitôt après la détresse de ces jours-là, le soleil s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté ; les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. »
Chantons les Litanies, le Notre-Père, l’Ave Maria, invoquons saint Michel Archange, saint Joseph, saint Augustin ainsi que les saints qui nous sont chers.
Dieu vous bénisse, vous et votre famille, en ces temps de chaos.
Stéphane
19 mars 2020
Paroles latines/françaises de l’offertorium « Terra Tremuit »
Terra tremuit, et quievit, dum resurgeret in iudicio Deus.
La terre a tremblé et s’est tue, quand Dieu s’est relevé pour le jugement.
Notus in Iudaea Deus, in Israel magnum nomen eius.
Dieu est connu dans la Judée : en Israël, grand est son nom.
Et factus est in pace locus eius et habitatio eius in Sion.
Et son séjour a été établi dans la paix : et sa demeure dans Sion.
Ibi confregit cornu, arcum, scutum et gladium et bellum : illuminans tu mirabiliter a montibus aeternis.
C’est là qu’il a brisé la puissance, l’arc, le bouclier, et le glaive et la guerre : tandis que vous, vous resplendissez merveilleusement du haut des montagnes éternelles.
Paroles latines/françaises de « Salve Regina »
Salve, Regína, mater misericórdiae ; vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Salut, ô Reine, Mère de Miséricorde, notre vie, notre douceur, et notre espérance, salut.
Ad te clamámus, éxules fílii Evae.
Vers vous nous élevons nos cris, pauvres exilés, malheureux enfants d’Eve.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes in hac lacrimárum valle.
Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes.
Eia ergo, advocáta nostra, illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte.
De grâce donc, ô notre Avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux.
Et Jesum, benedíctum frucum ventris tui, nobis post hoc exsílium osténde.
Et, après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María.
Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie.
Lien vers le fichier PDF : https://lafrancechretienne.files.wordpress.com/2020/03/la_strategie_du_chaos_v01.pdf